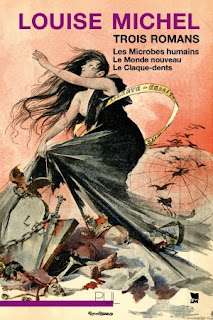Résumé
du chapitre précédent :
L'histoire
se passe dans x années. Le monde entier se bat en employant les
procédés les plus perfectionnés. Des villes, des pays, des
continents sont anéantis. Lord Harry Mac Carthy a combattu à la
tête de l'escadre aérienne. Dernier survivant de son armée, il
rentre et ne rencontre pas âme qui vive. Alors, tristement, il se
met en smoking pour dîner seul parmi les automates que les gaz ont
épargnés.
Mac,
troublé, s'avançait dans un sens interdit. Il s'entendit soudain
dresser un procès verbal par un phonographe à roues. Loin de se
sentir irrité par cette intervention, il éprouva une émotion qui
ressemblait si bien à de la tendresse qu'il prit plaisir à verser
très lentement, en menue monnaie, le montant de son amende. Quand il
vit s'éloigner la machine, il courut se replacer devant elle et se
rendit compte qu'il l'eut prié à genoux de lui faire entendre
encore le son d'une voix humaine. Enfin, il l'empoigna et la traîna
jusque chez lui.
Il
était accoutumé à manger seul. Quand il se fut assis sur son
tabouret d'aluminium, devant l'espèce de standard téléphonique à
robinets qui lui servait la table et qu'il eut, moyennant un assez
nombre de pièces d'or, introduites dans un compteur, obtenu une
assiette de pommes de terre synthétiques et une tasse de thé
artificiel, il eut pu se croire reporté à quelques mois en arrière,
au temps où le monde existait encore. Reprenant quelque force avec
la nourriture, il sentait s'alléger un peu le poids qui
l'oppressait. Il eut même le courage, pour stimuler son énergie, de
dire à haute voix : « Plus de gêneurs ! »
Presqu'aussitôt,
comme pour le démentir, le phonographe de police dont le mouvement
s'était dérégler, se mit à répéter : « Stop !
Six shillings… Stop ! Six shillings… Stop ! Six
shillings… Stop ! Six shillings... » avec une volubilité
si monotone et si intolérable que le malheureux Mac Carthy se leva
et le brisa d'un coup de poing. Il n'eut pas plutôt fait ce geste,
qu'une détente de ses nerfs le plongea dans le désespoir. En même
temps, un coup de vent provoqua un appel d'air dans la cheminée qui
avait été pratiquée au plafond et qui montait jusqu'au sommet de
la montagne, pour relier la chambre aux hautes couches atmosphériques
en prévision des attaques par gaz.
Portée
par ce courant, une odeur horrible passait. Il se souvint alors que
es derniers compagnons massacrés gisaient partout autour de lui,
sans même bénéficier de la seule convention que les adversaires
fussent parvenus à établir entre eux, au cours de la guerre, et qui
avait consisté à user de gaz stérilisants pour n'avoir pas à
souffrir de l'impossibilité matérielle d'inhumer ou de brûler les
cadavres.
Fuyant
cette rafale empestée, il courut dehors. L'idée que c'était là
encore l'oeuvre des jaunes l'emplissait d'une indignation qui, peu à
peu, le tirait de son abattement. Dans sa colère, il revoyait toutes
les péripéties du combat aérien d'où il était revenu seul.
Au-dessous de lui, la plaine de Salt Lake City étendait ses docks et
ses arsenaux de béton, comme des sépulcres : une sèche rumeur
de chocs et de roulements sur rails montait dans la nuit ; en
haut de grands squelettes d'acier, quelques phares et quelques
signaux perçaient l'ombre, par saccades, de leurs feux
intermittents ; dans ce cimetière où, seule, la machine
conservait encore le mouvement, pas un coeur qui battit, pas une
goutte de sang qui réchauffât une fleur de chair. La lutte des
gerfauts qu'il avait, en un double jour, menée dans la trace du
soleil, avec l'ardeur d'une bête et le génie d'un dieu, enflammait
son souvenir d'amour pour la vie disparue.
Soudain,
il se rappela le dernier ennemi dont le vol s'était évanoui avec le
jour.
Alors,
il descendit jusqu'à l'aéroport, entra dans son avion, le soulagea
de son chargement funèbre et mit à la place toutes les munitions
qu'il put y faire entrer. Quand ce fut le matin, il partit.
Il
allait, précédant le soleil. Quand il baissait les yeux, il voyait,
sur les nuages, l'ombre de ses deux ailes qui courait devant lui. Il
avait retrouvé la volonté avec un but : revoir un homme
encore, venger sur lui sa race, et mourir en le frappant.
Il
ne cherchait pas sur la terre, car la terre n'était plus la nourrice
des hommes. Elle n'était d'ailleurs visible presqu'en aucun lieu. Un
océan brumeux l'enveloppait tout entière, où les nuées des orages
surplombaient les nuées de la mort en un chaos où la lumière
indifférente avait d'éblouissants caprices comme un enfant qui joue
aux osselets sur une tombe. Si, parfois, une tempête fondait de son
éperon les flots mous de ce nouveau déluge, on voyait, dans la
plaie ouverte, apparaître des plaines sans moissons, des prairies
sans herbe et des forêts sans feuilles, autour des villes sans feux,
sans lumière et sans bruits, dont les places étaient noircies d'une
inerte poussière humaine.
Mac
Carthy pouvait croire qu'il avait franchi l'éther et qu'il
découvrait une planète éteinte. Mais cet astre mort était sa
patrie et sa mère, et lui, jamais, ne pourrait, si violent que fut
son essor, partir pour un autre univers. Jamais, depuis les temps,
nul n'avait subi pareille épreuve. Aussi, dans son âme froide et
son cœur dur, il ne restait plus qu'un désir : le coup de
grâce du dernier combat.
Il
refaisait la route qu'il avait, quelques jours avant, suivie avec
escadre. Il reconnut bientôt les hauteurs du Thibet. Les masses de
vapeurs dont il les avait inondées, colorées par les réactifs,
flottaient maintenant sur les plateaux, se concentraient dans les
vallées, roulaient en rouges catarecates le long des pentes et
descendaient sur la Chine.
Enfin,
perçant cette mer de voiles mouvants, parurent, légers, aériens,
diaphanes, enluminés par l'aurore de rubis scintillant parmi les
cristaux des glaciers et l'indigo teignant les neiges, les sommets de
l'Himalaya.
Là
seulement, avait pu se réfugier encore l'avion qu'il poursuivait.
Il
se mit à sa recherche en donnant toute sa vitesse et, durant
plusieurs heures, il tournoya comme un corbeau près d'un clocher,
autour des pics vertigineux. Enfin, il vit, semblant se détacher
d'un nid, au bord d'un précipice, à peine distinctes du manteau
blanc qui vêtait toutes choses, planer au loin deux ailes comme une
colombe.
Pour
l'appeler au combat, il ouvrit l'échappement et fondit sur elle,
avec un bruit de tonnerre. L'oiseau s'éleva, fit face et vint à sa
rencontre.
Le
plan de Mac Carthy était simple : se jeter en droite ligne sur
l'ennemi qui, ne pouvant avoir d'autre désir que celui qu'il avait
lui-même, ne se déroberait pas. En une seconde, tout avait changé
dans son âme. La seule pensée qu'un homme vivant était devant lui,
avait dissipé l'horreur lourde qui l'oppressait depuis tant de
jours. Le monde n'était plus vide ; il ne demeurerait pas
seul ; il allait venger les siens.
La
colombe grandissait et devenait un monstre à l'envergure démesurée.
Elle
venait aussi en ligne droite. Il la touchait. C'était la fin. Tout à
coup elle laissa tomber, comme un grain de mil, un corps qui aussitôt
fut soutenu par un parachute. Harry, d'un coup de volant, s'envola en
un looping et évita le choc.
Pour
la première fois depuis le jour de sa naissance, il perdit
entièrement la maîtrise de lui-même. Sa carlingue fut emplie du
tumulte des imprécations les plus désordonnées. Penché sur son
périscope, il suivait la lente descente de l'aviateur qu'il arrosait
maintenant de l'averse de sa mitrailleuse. Bientôt, il vit une
déchirure se faire dans la large ombrelle. Puis l'étoffe s'ouvrit
largement et le corps, verticalement, tomba.
La
joie du vainqueur fut courte. Au plaisir purement instinctif d'avoir
riposté à ce qu'il considérait comme une traîtrise, succéda la
tristesse d'avoir échouer dans son dessein. De nouveau, il se
retrouvait seul. Sa colère s'apaisant, il se sentit gagné par un
désespoir plus profond encore que celui qui l'avait accablé avant
son départ. Il venait de tuer de sa main le dernier être vivant. Il
l'enviait. Soudain, il cala son moteur pour tomber à son tour. A ce
moment, il se demanda pourquoi son adversaire avait voulu vivre
encore. Quel espoir, quelle source de joie avait pu, au moment
suprême, le rattacher à la terre ? Puis un doute, une
curiosité confuse, inconsciente, se fit en lui : l'autre
était-il mort en tombant ?
Mac
Carthy constata qu'il n'avait pas lâché la direction. Son avion
tenait encore l'air ; il descendit en vol plané.
L'atterrissage
sur les sommets de l'Himalaya présentait des difficultés. Harry
brisa son appareil mais en sortit indemne.
Il
voyait au-dessous de lui, au bas d'une pente unie, dans une poche de
neige, un trou formant une ombre. Les lambeaux du parachute
indiquaient assez qu'à cette place gisait le vaincu du combat.
Si,
au lieu d'être homme d'action, le jeune Écossais eut été habitué
à se regarder vivre, il se fut peut-être demandé quel sentiment
avait été le plus fort en lui quand il avait été le plus fort en
lui quand il avait quitté Salt Lake City : le désir de la
vengeance ou le besoin de revoir un être humain ? Si tout avait
été regret dans son âme quand il avait vu l'ennemi lui échapper
et joie dans son cœur, quand il l'avait enfin abattu ? Il eut
peut-être aussi cherché pourquoi il descendait, à cet instant, un
revolver à la main, sans raquettes, sans piolet ni corde, une
patinoire inclinée à 45°, pour aller voir un homme mort, sur
lequel il reportait la haine d'une moitié de l'humanité défunte.
Mais
la psychologie ne l'intéresserait nullement. Elle l'intéressa moins
que jamais quand il fut parvenu au bord de l'entonnoir que la chute
du corps avait creusé dans la neige.
Il
avait sous les yeux un pâle visage aux yeux noirs, crispé par la
souffrance. Seul, le buste émergeait de la couche profonde où les
membres étaient enfouis. Une main pourtant lacérait, de ses doigts
déliés, l'étoffe couvrant la poitrine et dégageait, dans ce
mouvement, parmi les taches roses d'un peu de sang répandu, un sein
de femme ambré, poli comme l'ivoire.
La
blessée regardait Harry, comme l'alouette abattue regarde le chien
du chasseur. Soudain sa bouche s'entrouvit et sa voix faible
murmura :
– Peace ?
Harry
perçut, près de lui, la chute de son revolver.
– Peace !
répondait sa voix grave.
Il
la hissa doucement et l'étendit sur le sol. Les balles ne
paraissaient pas l'avoir mortellement atteinte. Il remonta
péniblement jusqu'à son avion brisé et en rapporta des remèdes.
Quand
il la vit moins faible, il lui demanda :
– Pourquoi
ne vouliez-vous pas mourir ?
Elle
étendit la main vers le bas de la vallée.
– Des
hommes, encore ? dit-il.
– Non !
fit-elle en souriant, non… menez-moi là-bas.
Il
la prit dans ses bras, car elle était légère comme une petite
fille. Bientôt, ils trouvèrent un ruisseau étroit, creusé entre
les glaces par les premiers souffles de l'été. Il y entra :
sur les pierres que l'eau découvrait, il put marcher plus
facilement. Plus loin, des rives de gazon s'offrirent à droite et à
gauche. Enfin, le fond de la vallée s'élargit en une prairie où
fondaient des taches de neige.
Parfois,
il la posait sur l'herbe ; puis il la reprenait. Et il se
sentait si fort en marchant qu'il eût dit que c'était elle qui le
soulevait. Quand ils eurent ainsi descendu très longtemps, ils
aperçurent des arbres verts…
Depuis
plusieurs mois, il croyait qu'il n'y en avait plus et il se mit à
chanter.
Alors,
un doigt sur la bouche, elle lui fit signe d'écouter. Il se tut. Le
cristal de l'air vibrait d'un concert d'oiseaux. Il en vit voler sur
les branches ; Il se rappela qu'étant enfant il en avait tenu
quelques fois dans sa main, qu'ils étaient chauds et que leur coeur
battait sous ses doigts. Soudain, il s'arrêta : un troupeau de
mouflons sauvages, étonné de la voir, venait à sa rencontre.
A
mesure qu'ils descendaient, la nature devenait plus vivante. Il
marchait maintenant sous le couvert d'un bois ; ses pieds
foulaient les fraises dans la mousse, comme une vendange, et son
front éveillait un bourdonnement d'abeilles, en frôlant les fleurs
de rhododendrons. Ils rencontraient des ours, des cerfs, des
écureuils, toutes sortes de bêtes qui les regardaient avec douceur
et, parfois, se laissaient caresser.
Enfin,
ils arrivèrent à l'extrémité de la vallée. De cascade en
cascade, le ruisseau était devenu un torrent puis une rivière puis
un grand fleuve. Brusquement il disparaissait, au bord d'un abîme
sans fond, au-delà duquel on ne voyait plis que les nuages du ciel.
Harry
ne s'arrêta qu'au bord du gouffre. A trois mille pieds au-dessous
d'eux, ils distinguaient confusément les traînées de gaz qui
poursuivaient leur lente chute vers l'Asie. Il détourna la tête et
demanda à la jeune fille où elle voulait aller encore.
Il
y avait, près de là, une pelouse sous un cède. Il l'y porta. Et,
comme il s'agenouillait pour la coucher sur l'herbe, une biche et son
faon vinrent les heurter en gambadant.
– Ils
n'ont jamais vu d'homme, dit-elle, et ne nous craignent pas.
Il
songeait au gouffre, à la planète morte, au désert de Salt Lake
City, aux policemen automatiques qui, à cet instant, devaient
débiter encore, dans la solitude, leurs ordres nasillards. Il
frissonna.
Elle
crut qu'il avait la fièvre. Cueillant une large feuille,
l'approchant des mamelles de la biche, elle l'emplit de lait, comme
une coupe, et la tendit à Harry.
Ils
la vidèrent ensemble. Et quand la feuille fut vide, leurs lèvres se
touchèrent.
Et
ce fut le recommencement.
FIN
Retrouvez tous les articles consacrés au magazine VU en cliquant ICI.